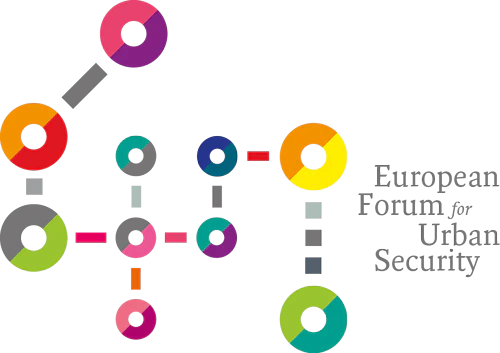Interview avec Manuel Comeron, responsable de la Prévention à la Ville de Liège
À quel moment la ville de Liège a-t-elle été confrontée à la problématique du radicalisme violent ?
Manuel Comeron : Le phénomène est apparu progressivement, mais c’est surtout à partir de 2013 qu’il a pris de l’ampleur. À Liège, comme dans d’autres villes européennes, nous avons été confrontés au départ de jeunes vers les zones de combats, notamment en Syrie où s’était constitué l’État islamique (EI). Dans ces années-là, environ 700 jeunes d’une moyenne d’âge de 23 ans ont quitté la Belgique pour rejoindre l’EI en Syrie. Les attentats du Bataclan à Paris en novembre 2015 et à Bruxelles en mars 2016 ont marqué un tournant : nous étions face à un terrorisme structuré.

Quelle stratégie la Ville de Liège a-t-elle mis en place à ce moment-là ?
Elle n’a pas réagi seule : c’est d’abord une réaction à l’échelle nationale avec en parallèle un mouvement européen qui a commencé à se dessiner. Dès 2014, l’Efus a organisé des réunions dans le cadre du projet LIAISE (Local Institutions Against Violent Extremism) dans l’objectif de permettre aux villes européennes d’échanger directement entre elles sur une problématique qui les concernait toutes. A Liège, dès 2013, nous avons entamé un travail de diagnostic en impliquant la police, les acteurs sociaux et l’université, puis très vite en activant une concertation locale au départ de la Ville. Les attentats aux quatre coins de l’Europe ont accéléré les choses : il était urgent de travailler avec tous les acteurs locaux, de manière transversale, méthode largement éprouvée par l’Efus. C’est ainsi qu’est née la Cellule de Sécurité Intégrale Locale (CSIL), pilotée par le maire, qui a permis de lancer très vite des actions en prévention sociale. Depuis 2018, il s’agit d’une obligation pour toutes les communes belges.
« Beaucoup d’actions menées à Liège s’inspirent directement d’expériences européennes comme celles de Madrid et L’Hospitalet (Espagne), de Berlin et Augsbourg (Allemagne), de Paris et Strasbourg (France), de Bruxelles et Malines (Belgique) ou encore Londres (Royaume-Uni) avec le programme Prevent ».
Quel rôle a joué l’Efus dans ce processus ?
Il a joué un rôle décisif. Dès 2014, avec le projet LIAISE, nous avons pu échanger avec d’autres villes européennes. Pour la première fois, les acteurs sociaux et éducatifs étaient impliqués aux côtés de la police dans la lutte contre le terrorisme alors que nous étions confrontés à un défi majeur. L’Efus nous a permis de bénéficier de formations de haut niveau, de partager des pratiques et de ne pas rester isolés. Beaucoup d’actions menées à Liège s’inspirent directement d’expériences européennes, comme celles de Madrid et L’Hospitalet (Espagne), de Berlin et Augsbourg (Allemagne), de Paris et Strasbourg (France), de Bruxelles et Malines (Belgique) ou encore Londres (Royaume-Uni) avec le programme britannique Prevent.
L’extrémisme islamiste semble avoir ajourd’hui reflué, mais d’autres formes de radicalisme violent ont émergé. Comment évaluez-vous la situation aujourd’hui ?
Le climat est plus apaisé qu’il y a dix ans avec la diminution relative des attaques, mais le phénomène de la radicalisation menant à la violence est toujours prévalent car de nombreux attentats sont déjoués par les services de sécurité. Nous faisons face à une double menace : d’une part l’islamisme violent, qui n’a pas du tout disparu car les attaques persistent et l’idéologie se diffuse de façon inquiétante, et d’autre part la montée de l’extrémisme de droite avec des groupuscules en Allemagne, France ou Angleterre prêts à l’action. Sur le terrain, en matière de discours extrémistes ou de comportements religieux radicaux, nous continuons à détecter des signaux dans les écoles ou certains quartiers et nous travaillons avec les secteurs de l’enseignement et de la jeunesse pour éviter l’exclusion scolaire et sociale qui peut conduire à la radicalisation.
Quels défis persistent ?
Le principal défi est celui de la polarisation de la société. Les crises internationales, le Covid, les violences en ligne, tout cela renforce les divisions dans la population. Nous devons réaffirmer les valeurs démocratiques et maintenir des espaces de dialogue, tout en protégeant les élus et les institutions de la violence verbale et physique. Un autre défi est celui de la santé mentale : de plus en plus de situations de radicalisation révèlent une fragilité psychologique, même si cela n’explique pas tout.
Que retenir de l’expérience liégeoise ?
Que la prévention du radicalisme violent ne se limite pas à la sécurité. C’est un travail transversal, culturel, éducatif et social. Les villes ne peuvent agir seules : elles doivent coopérer entre elles et avec la société civile. Surtout, elles doivent recevoir l’appui structurel et le soutien financier du niveau national. À Liège, nous estimons que renforcer la cohésion sociale et stimuler le sentiment positif d’appartenance locale est aussi une forme de protection contre l’extrémisme. C’est tout à fait en ligne avec l’approche de l’Efus.
Photo en haut : l’entrée de la gare centrale de Liège – ©iStock – BalkansCat
La stratégie de prévention de la ville de Liège
La cellule liégeoise de prévention de la radicalisation violente, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur, agit dans les domaines suivants :
- Information ou conseil de première ligne vers les citoyen.ne.s et orientation vers les services spécialisés.
- Sensibilisation ou formation thématique vers les professionnel.le.s du travail éducatif, social et interculturel.
- Coordination de la concertation intersectorielle de prévention (CSIL) et développement d’une stratégie locale d’action.
- Organisation d’activités pédagogiques en relation avec les dispositifs Jeunesse, Aide en Milieu Ouvert, Culture, Enseignement et Intégration.
- Développement de programmes d’accompagnement psychosocial en coopération avec l’Université de Liège.
- Relais vers les autorités nationales (ministère de l’Intérieur), régionales et participation à des échanges internationaux notamment via l’Efus et le Strong Cities Network.
Manuel Comeron : Nous agissons sur tout le spectre de la prévention (primaire, secondaire et tertiaire). Par exemple, en prévention primaire, nous avons impulsé une pièce de théâtre (Nadia) présentée dans les écoles à des milliers d’adolescents, organisé des projections de films suivis de débats, et plus récemment créé un parcours pédestre dans la ville intitulé Démocratie, Tolérance et Libertés qui mène les visiteurs vers des lieux ou monuments symboliques de ces valeurs.
En prévention secondaire, nous avons notamment participé au projet de l’Efus Local Voices (stratégies locales de communication pour prévenir l’extrémisme, 2017-2018) qui permettait à des jeunes de quartiers de créer une campagne de communication contre les discours extrémistes avec la réalisation d’un vidéo-clip artistique (musique, danse, écriture) largement diffusé sur les réseaux sociaux.
Enfin, en prévention tertiaire, dans le cadre de la CSIL-R opérationnelle, nous effectuons un accompagnement social individualisé pour des personnes déjà radicalisées, avec des centres d’action sociale, d’insertion professionnelle, d’intégration interculturelle et de santé mentale ainsi que le concours de l’université.
> L’Efus a publié plusieurs ouvrages sur la prévention de la radicalisation violente et de la polarisation, résultant de projets européens :
- LOUD – Quand les collectivités territoriales et les jeunes de neuf villes européennes se mobilisent contre l’intolérance et l’extrémisme (Efus, 2021)
- BRIDGE – Comprendre et mesurer la polarisation au niveau local (Efus, 2021)
- PRACTICIES – Partenariat contre la radicalisation violente dans les villes (Efus, 2020)
- PREPARE : La prévention de la radicalisation dans le cadre de la probation et de la sortie de prison (Efus, 2019)
- Prévention de la radicalisation violente – Guide méthodologique pour l’élaboration d’une stratégie (Efus, 2017)
- Prévenir et lutter contre la radicalisation à l’échelon local (Efus, 2016)
- Villes contre le terrorisme (Efus, 2007)